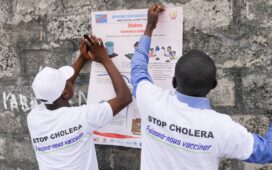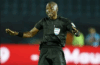MediaCongo Press > BLOG > A la une >

Posté sur
Dans une étude intitulée « Uncertainty in Preferential Trade Agreements : Impact of AGOA Suspension on Exports », la Banque mondiale (BM) évalue l’impact de la suspension de 14 pays africains, dont la République démocratique du Congo, entre 2001 et 2021. À cet effet, la BM relève un risque potentiel de l’application d’un accord commercial unilatéral et non réciproque sur les économies en développement. Tout en appelant à des accords plus « réciproques », l’institution de Bretton Woods invite l’Afrique subsaharienne à diversifier les marchés d’exportation et à renforcer les échanges commerciaux intra régionaux.
Pour la RDC, le grand retour au sein de l’African Growt And Opportunity Act, AGOA en sigle, était, avant tout, une victoire diplomatique. En effet, loin de ne constituer qu’un simple cadre approprié pour des échanges commerciaux, ce dispositif bien rôdé permet aux États-Unis d’Amérique d’en faire un instrument majeur de sa politique africaine, sanctionnant, le cas échéant, les pays qui affichent des reculs démocratiques. Depuis sa création en 2000, il y a 23 ans, l’AGOA permet aujourd’hui l’entrée en franchise de droits de douane d’environ 1 800 produits des pays africains éligibles sur le sol américain. Toutefois, indique la BM, il faut ajouter au moins 5 000 autres produits qui peuvent bénéficier également d’un régime d’exception, à travers le Système généralisé de préférences commerciales (Generalized System of Preferences / GSP), lancé en 1974. Au moins cent pays en développement bénéficient de ces taux tarifaires réduits ou nuls.
Au sujet des deux systèmes, le constat amer tiré par la BM est l’absence d’un véritable traitement préférentiel des marchandises. Par ailleurs, en se référant à l’analyse de la BM, l’actualisation de la liste semble bien obéïr à des critères plus politiques que commerciaux, notamment l’attachement à l’économie du marché, le respect de l’État de droit et la mise en œuvre effective des politiques de lutte contre la pauvreté. À cela, il faut ajouter d’autres éléments d’appréciation, plus ou moins objectifs, comme les avancées ou les reculs démocratiques des pays concernés. Analysant ces critères, les États-Unis d’Amérique décident de la suspension ou de la réadmission d’un pays.
Le volet important de l’étude concerne surtout l’impact d’une suspension sur une durée plus ou moins longue. Cet impact peut être évalué à trois niveaux : la durée de suspension, le taux d’utilisation et les secteurs concernés. D’emblée, la suspension des pays d’Afrique subsaharienne du régime AGOA peut entraîner, en moyenne, une baisse de 39 % de leurs exportations vers les États-Unis d’Amérique. « L’impact de la suspension d’un pays bénéficiaire du programme AGOA sur ses exportations vers les États-Unis d’Amérique est jusqu’à dix fois plus important que celui de sa suspension du système généralisé de préférences ».
Les pays suspendus pendant plus de deux ans ont connu une baisse de leurs exportations vers les USA de l’ordre de 45 % en moyenne. Dans les pays où le taux d’utilisation est de plus de 30 %, la suspension entraîne en moyenne un recul de 65 % des exportations vers les États-Unis d’Amérique. Enfin, selon les secteurs, on a connu une baisse de 88 % des exportations de textile et habillement des pays suspendus vers l’Amérique, alors que d’autres secteurs comme l’agriculture, l’industrie et les minerais n’ont pas enregistré d’impact majeur.
Réadmise à l’AGOA en 2020, la RDC devrait, outre s’approprier des recommandations de la BM, mieux s’investir également sur la compétitivité de ses produits locaux. Le tabac, le blé, le café, le caoutchouc, le bois et l’huile de palme sont autant de produits exportables à condition de mettre en place un ensemble de normes de standard de production acceptables aux niveaux national et international.
Laurent Ifayemba
MediaCongo Press
laisser un commentaire