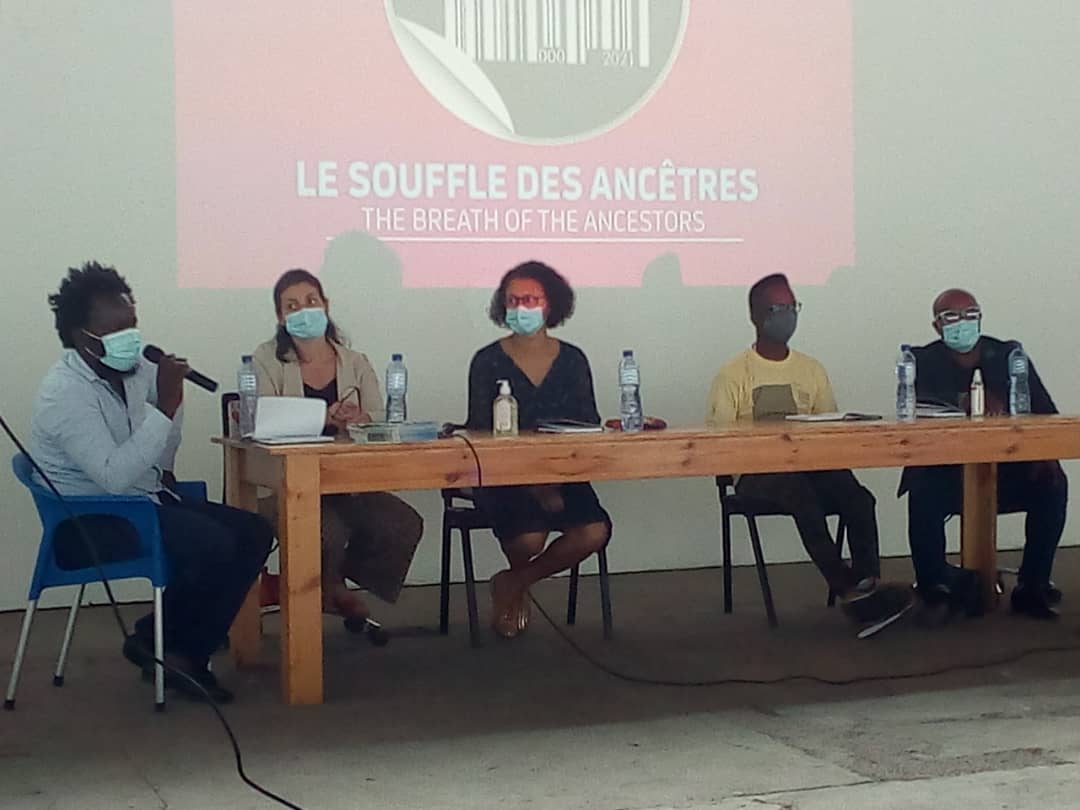MediaCongo Press > BLOG > A la une > Accord Rwanda-RDC : « en acceptant de signer des accords de paix avec la RDC, Kagame reconnaît son soutien au M23 » (Massad Boulos)
La signature de l’accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, tenue le 27 juin dernier à Washington sous l’égide des États-Unis, continue de susciter des réactions sur la scène diplomatique internationale. Pour Massad Boulos, conseiller spécial du Secrétaire d’État américain, « en acceptant de signer cet accord, Paul Kagame reconnaît implicitement le soutien de son régime au M23 », un groupe rebelle accusé de graves exactions dans l’est de la RDC.
L’accord signé engage les deux parties à respecter mutuellement l’intégrité territoriale, à cesser les hostilités, à œuvrer pour le désarmement des groupes armés et à favoriser leur intégration conditionnelle dans la vie civile ou militaire. Mais pour Massad Boulos, la portée de l’accord va bien au-delà : « Le Rwanda ne peut plus nier son implication dans la déstabilisation de l’est du Congo. En apposant sa signature, Kagame admet sa responsabilité, même tacitement », a-t-il déclaré dans une interview accordée à BBC.
Un avertissement clair
Dans un ton ferme, Boulos a averti que « si l’accord n’est pas respecté, les deux pays seront soumis aux mêmes conséquences ». Cette déclaration est perçue comme un message fort de la diplomatie américaine, qui ne tolérera plus les manœuvres dilatoires ni les violations répétées des engagements pris.
L’administration américaine, qui a facilité la reprise du dialogue entre Kinshasa et Kigali, considère cet accord comme une opportunité historique pour sortir de l’impasse sécuritaire dans la région des Grands Lacs.
Kinshasa accuse depuis plusieurs années le Rwanda de soutenir militairement et logistiquement le M23, ce que Kigali a toujours nié. De son côté, le Rwanda justifie sa présence à la frontière par la menace que représentent les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (Fdlr), un groupe armé opposé au régime rwandais.
Djodjo Vondi
MediaCongo Press
laisser un commentaire